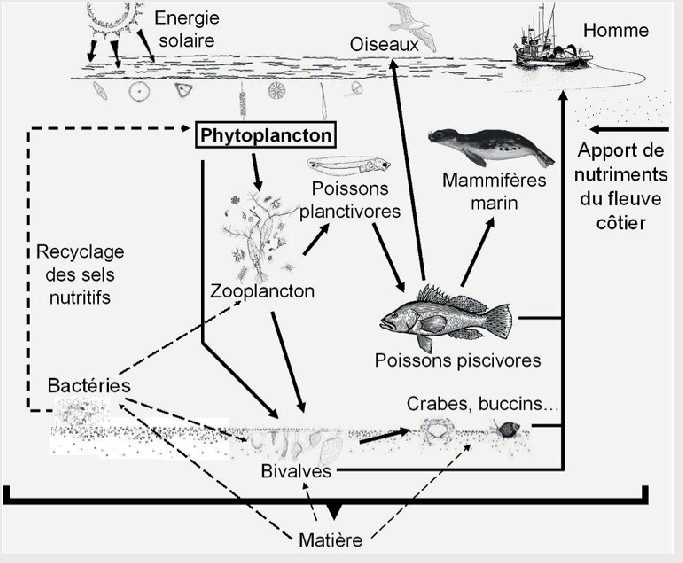QUAND CROIX-DE-VIE ET SAINT-GILLES-SUR-VIE SE FIRENT PORTS SARDINIERS.
Au XIXème siècle, les ports de Saint-Gilles sur-Vie et de Croix-de-Vie, souvent ensablés, se prêtaient de plus en plus mal aux exigences du trafic maritime marchand.
D’importants bancs de sardines se présentaient alors régulièrement, aux beaux jours, à portée d’avirons. Les marins saisirent leur chance, associant étroitement la pêche et les conserveries.
Depuis l’Antiquité, on sait conserver les aliments, confits dans le sel. Au Moyen Âge on utilisait déjà des «presses en baril», sorte de tonneaux percés de trous dans lesquels on tassait légumes, viandes ou poissons entre des couches de sel. En 1835, on comptait à Saint Gilles-sur-Vie trois presses en baril, ou «saurisseries». L’une d’elle était la propriété du sieur JUHEL. Le sieur COLIN, un industriel nantais, fut le premier confiseur à associer, en 1830, l’appertisation* (1809) à la ferblanterie. La renommée de ses sardines ainsi conservées le poussa à sortir 100 000 boîtes par an en 1836. Fort de ce succès, il installa une fabrique à Saint-Gilles-sur-Vie.

vaudage d’un chalut sur le quai sud de la 1ère darse du port de Saint-‐Gilles-‐Croix-‐de-‐Vie. Ravaudage d’un chalut sur le quai de la 1ère
darse du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Le 2 juin 1850, la réussite du sieur COLIN donna l’idée à deux nantais, Messieurs TERTRAIS et BALLEREAU, d’industrialiser la fabrication. Ils implantèrent une première conserverie à Croix de-Vie, à l’emplacement actuel de la salle de la «Conserverie». Plus tard, SAUPIQUET leur succédera. Ils furent imités par Messieurs LEJEAU et DEFESSES qui acquirent le château COLLINET où ils construisirent leur usine, reprise ensuite par CASSEGRAIN, puis par GENDREAU.
En 1883, à Croix-de-Vie une quarantaine de conserveries s’échelonnaient depuis la baie de l’Adon, jusqu’au quai Gorin. Les tables bourgeoises et les casse-croûtes faisaient une place de choix aux conserves de sardines cuites à l’huile d’olive. En 1880, les Parisiens consommaient 300 tonnes de sardines à l’huile par an. L’arrivée du chemin de fer à Croix de-Vie en 1885, permit la commercialisation des boîtes de sardines sur tout le territoire national voire international.
Les familles des marins-pêcheurs n’ap préhendèrent plus l’hiver. Le nombre de pêcheurs sardiniers quadrupla de 1830 à 1906. En 1850, la flottille vendéenne compta 600 bateaux dont l’essentiel était basé à Saint-Gilles et Croix-de-Vie. Jusqu’en 1900 elle était composée de chaloupes de 7 m le long et de 2,60 m de large avec un tirant d’eau de 1,10 m. Ces chaloupes à faible tirant d’eau et fortement voilées, manœuvrées à l’aviron par des équipages de 5 hommes étaient bien adaptées à une côte dangereuse truffée de hauts fonds et de bancs de sable. Voilures déployées, les chaloupes portaient haut foc, misaine, taillevent, un ou deux huniers surmon tant deux voiles au tiers majeures et, parfois, un tape cul à livarde. Ainsi parées, les chaloupes avaient fière allure.
Le succès de cette pêche transformée et commercialisée par les conserveries attira, en saison estivale, des paysans audacieux qui, les moissons faites, se lançaient sur les flots. Ces nouveaux venus, fraîchement accueillis par les marins du cru, étaient surnommés «marins patates». Mais à l’époque, il y avait assez de sardines pour tout le monde.

La prospérité était cependant inégalement répartie. La capitalisation de certaines usines se révéla fragile dès que la sardine se fit capricieuse. Les campagnes sardinières de 1846, 1852, 1858, 1872 furent médiocres mais les conserveries résistèrent, fortes de leur monopole. De 1880 à 1887, la pénurie frappa le littoral, épargnant les côtes de Saint-Gilles et de Croix-de-Vie en 1880 et 1881. Ce ne fut qu’un répit. En 1890, après une succession de faillites et de rachats, seule une quinzaine de conserveries subsistaient à Croix-de-Vie. Déjà, depuis 1886, des industriels installaient des usines au Portugal et en Espagne créant leur propre concurrence. La pénurie de sardines jeta les familles de pêcheurs du littoral breton et vendéen dans la misère et poussa à la création de comités de secours. La crise mit en évidence les intérêts économiques et sociaux qui opposaient les conserveurs et les pêcheurs. Les premiers voulaient augmenter le rendement de la pêche par la modernisation de flottilles plus puissantes et l’évolution des techniques. Les seconds craignaient l’appauvrissement des stocks et la concentration des richesses dans les mains de ceux capables d’investir au détriment des autres. Les pêcheurs utilisèrent le filet tournant tardivement craignant déjà la surpêche et dénonçant l’écrasement des poissons au détriment de leur qualité. De plus, les fortes prises minoraient leur valorisation ne les faisant pas mieux vivre que lors des années médiocres. Si leurs intérêts étaient mieux préservés lors des années de rendement moyen, pourquoi investir et s’endetter ? Pour se faire mieux entendre, les pêcheurs se dotèrent d’organisations professionnelles capables de défendre leurs intérêts et de les représenter auprès des décideurs. La loi sur la pêche de 1852 et les décrets de 1853 et 1859 réglementèrent l’usage des sennes et interdirent le chalutage à moins de 3 milles des côtes. A la fin du XIXème siècle, la sardine, de capricieuse se fit rare. Le retour des sardines en 1909 amena les capitaines les plus fortunés à faire construire des «gazelles» capables de traquer la sardine plus loin et plus longtemps. Tandis que ceux qui se contentaient d’une pêche d’appoint optèrent pour des bateaux plus petits manœuvrés à trois, les Quimperlés, sur le modèle d’embarcations bretonnes adaptées à la petite pêche côtière à l’année et à la sardine l’été.
Les cours fluctuaient au gré des rendements de la pêche et de la demande. C’est ainsi qu’en début de saison, en 1912, le «mille» était payé par les conserveurs entre 15 et 20 francs tandis qu’il baissait à 8/12 francs en fin de saison. Les ouvrières ne voyaient pas leur travail mieux rémunéré avec 0,20 francs de l’heure à la même époque, de jour comme de nuit, sans garantie du nombre d’heures rémunérées. Elles percevaient des jetons par quart d’heure travaillé monnayé à la semaine. En 1917, suivant l’exemple des ouvrières des Sables-d’Olonne, elles ont fait grève et obtinrent 25 francs de l’heure. Plus tard, pendant les années 1920-1930, une pêche trop abondante a saturé les capacités de traitement des usines. Les poissons, faute d’acquéreurs, furent rejetés dans le port. Les conserveurs des Sables-d’Olonne vinrent profiter de l’aubaine, au grand dam des marins-pêcheurs sablais. Pire, des marins bretons sont venus le 25 août vendre leurs maquereaux et firent s’effondrer les cours pour cette pêche. En 1927, les ouvrières firent cause commune avec les pêcheurs pour exiger que les conserveurs paient les prises à un prix acceptable. Forcés de négocier, les conserveurs acceptèrent que le prix soit fixé au vu et su de tous dans le cadre d’enchères publiques dans la nouvelle criée de Croix-de-Vie construite sur le quai, face à la gare.
Une crise de surproduction et de dé bouchés suivit l’augmentation des capacités de pêche jusqu’en 1931 sur un marché dominé par les productions portugaises, espagnoles et américaines. La qualité s’imposa pour y résister. Dès lors, l’enjeu pour les capitaines était autant le tonnage des prises que leur capacité à être les premiers à vendre en criée, à un bon prix, un poisson tout juste sorti de l’eau. Conscient de l’enjeu, dès 1925, Benjamin BENETEAU a été parmi les premiers à construire des sar diniers à moteur. Des aménagements portuaires sont entrepris: construction des cales et creusement du chenal, en 1937, creusement de la première darse en 1951 suivie par celui de la deuxième darse entre 1967 et 1971 abritant 450 marins, 135 bateaux dont 23 sardiniers, 12 thoniers, 10 caseyeurs, 40 chalutiers côtiers et 50 canots. La pêche faisait alors tourner 3 conserveries dont GENDREAU.
En 1967, les deux communes portuaires, Croix-de-Vie et Saint-Gilles sur-Vie fusionnent. La même année, Saint-Gilles-Croix-de-Vie ajoute une corde à son arc en se dotant d’un port de plaisance. Etabli sur la «Roussière», il compta d’abord 600 anneaux, puis bientôt 1000, toujours très demandés.
En 1993 le port abritait 106 navires sur lesquels embarquaient 300 marins-pêcheurs pratiquant une pêche diversifiée. Fort du dynamisme du port, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée, son gestionnaire, décida de moderniser la criée selon les normes européennes. En 1995 la nouvelle criée disposa d’une surface opérationnelle de 9 200 m2, d’une halle de vente de 3 000 m2 et de 14 ateliers de mareyage pour une coût de 30,5 millions de francs, le tout financé en partie par des subventions nationales et européennes. C’était sans compter avec «le plan Mellick», qui, en application de dispositions communautaires européennes, fit disparaître 40% de la flotte de pêche française, par vagues successives à partir de 1991. Le port paiera un lourd tribut, perdant des unités de pêche tandis que les équipages se dispersaient et que disparaissaient des compétences ancestrales. Suivirent la réduction des quotas de pêche aux anchois, la crise de 2008 et les premiers signes du changement climatique.
Depuis, de crise en crise, les marins-pêcheurs s’adaptent, modernisent et diversifient leur flotte et leurs techniques de pêche. Depuis 2006, l’entreprise GENDREAU reste la seule conserverie, après avoir intégré VIF ARGENT ex-SAUPIQUET. L’entreprise, partie prenante de l’activité portuaire, a armé deux unités de pêche. Depuis 2015, la Communauté de Communes assure efficacement la gestion de la criée, équipement indispensable à l’activité portuaire et source de notre attractivité touristique.
Le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie s’adapte et résiste.
darse du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
6
4
Le Port de Saint-‐Gilles-‐Croix-‐de-‐Vie, juillet 2021.
Sources :
– Chasse-Marée – Bateaux des côtes de France- Sar diniers de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et des Sables d’Olonne.
– «J’ai posé mon sac à terre, le port de Croix-de-Vie de 1950 à 1985» – Louis VRIGNEAU 2015.
– «Produits du Terroir et Recettes traditionnelles de Ven dée» – Edition l’Etrave 1995.
– «La crise sardinière française : les premières re cherches scientifiques autour d’une crise économique et sociale» par Marie-Hélène Durand, économiste ORSTOM.
* Appertisation : procédé mis au point par Nicolas Appert qui consiste à stériliser par la chaleur des denrées alimentaires périssables dans des contenants hermétiques (bocaux en verre ou boîtes métalliques) afin de les conser
ver durablement sans altérer leurs qualités gustatives et nutritives.
Le comité de rédaction