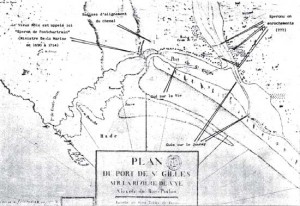Maurice Guittonneau a dressé un lexique des expressions maritimes qui s’enrichit tous les jours. Nous en poursuivons, ici, la publication dont des extraits avaient déjà paru dans le bulletin 2007.V.I.E vous invite à compléter ce lexique.
A vous !
- Bourolle Casier à crevette rose
- Bouc… crust. Crevette grise (boucaud)
- Baleresse crust. Etrille
- BAôue Banc de canot
- Baraôu poisson Tacaud
- Barbarin poisson Rouget barbet
- Billouque crust. Crabe vert de rivière
- Bernique coq. Patelle
- Brandoi Algue de roche sur l’estran
- Boguette Ecope en bois (ancien)
- Bande-molle Ferrure fixée sous la quille (semelle)
- Branleur- se Galopin, Gosse
- Branleur- se Grosse, Grand
- Branleuse de branlée Pris dans un fort grain en mer
- Bassiot’ Bassiquot’ Récipient carré ou rectangulaire en bois avec deux poignées
- Bousinne Genre de barbecue fait d’une caisse en bois sur pieds remplie de briques avec un foyer central (extérieur des maisons).
- Bia La mie d’un filet, d’une senne, chalut. Partie du filet non tendue
- Boyette Os de seiche
- Bordes Arêtes de poisson
- Bia-rat’ Petit gars , gamin
- Biroilloux Yeux sales purulents
- Borlaire Grande déchirure dans (filet ,voile , vêtement )
- Barbailler à fleur d’eau (tremper, toucher l’eau)
- Bornousé – Beurnousé Sale, graissé, barbouillé
- Baisé – baisaïe Se faire avoir….attrapé
- Baisé – baisïe bien baisé, baisé un coup de mer, baisé une maladie……..
- Bringueballe usuel pêche, barre d’embrayage moteur, levier, barre de pompe
- Baragouiner Parler de tout et de rien
- Baignoire Partie creuse sur petit bateau ponté, type voilier, pinasse à moteur
- Barroté Chargé au raz bord , plein
- Bafouet’ Vague et remous provoqué par le déplacement d’un bateau ou autre
- Bafouet’ Faire du bruit – un branleur de bafouet’ ( un grand bruit )
- Boucaille Crachin, bruine
- Boucailloux Se dit d’un temps bouché, brumeux, bruine
- Burgaue Bigorneau
- Baller Flotter sur l’eau (contraire de couler)
- Ballé Mal pêché vis-à-vis de l’ensemble des pêches
- Cantelette Palan de mât pour monter les charges et pochées de chalut
- Coquion coq. Coque
- Coffré Recouvert par un paquet de mer
- Cace- ss Retenue d’eau laissée dans les rochers, sur les plages et berges de rivière laissée par la marée descendante. Nom donné aussi à la vase
- Cassou Personne ou objet recouvert de vase
- Chumorlet’ poiss. Petit maquereau
- Coursia Petit cours d’eau qui rejoint la rivière (étier) venelle d’eau dans les rochers
- Cordelle (à la) Halage d’un bateau de la rive, Cordage
- Coillage Se dit de tout un ensemble matérielle de pêche, gréement, autres …
- Cotriade Part de poisson retenue sur la pêche pour la consommation du pêcheur
- Chambre Local à terre où le marin entrepose matériel de pêche, appât appelé aussi « chais »( Les Sables d’O)
- Clinche la Boisson alcoolisée vin … Embarquer la Clinche, le vin et autres alcools
- Clinche ( aller à la…) Endroit ou ce trouve l’alcool pour boire (cuisine, poste d’équipage cambuse, bistrot)
- Cojeanne ..(Yeu) Laminaire, Algue longue et large
- Coupe Bouquet de bois ou dune haute pour alignement
- Creuse Se dit d’une eau claire et limpide
- Castron poiss. petit de la seiche de cinq à dix cm