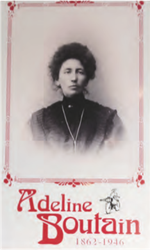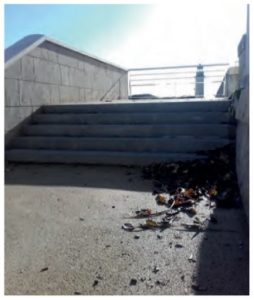Depuis le 5 septembre 2023, le patronyme Adeline BOUTAIN a été choisi par la Région des Pays de la Loire pour dénommer le tout récent Lycée Public Polyvalent de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Hors des sentiers battus, Adeline BOUTAIN, femme entreprenante menée par son goût de la photographie, a créé au début du siècle dernier un commerce florissant de cartes postales d’une grande valeur patrimoniale. Le choix de son nom dans la longue liste dressée, entre autres, par les élèves et les professeurs, a fait l’unanimité.
Deux ans déjà que le lycée a inauguré ses locaux fonctionnels à l’esthétique sobre.
A la rentrée 2023, les effectifs étaient au complet avec 577 élèves se répartissant entre les filières d’enseignement général, professionnel et technologique.
5 classes d’enseignement général de 2nde accueillent, chacune, 35 élèves.
La filière professionnelle propose aux élèves une palette d’apprentissages conduisant à des métiers recherchés :
• dans le domaine de la beauté et du bien-être avec :
– un baccalauréat Esthétique-Cosmétique-Parfumerie,
– un baccalauréat Métiers de la Coiffure,
• dans le domaine de l’électricité, de la plomberie et du chauffage avec :
– un CAP d’Electricien,
– un CAP de Monteur en Installations Thermiques,
– un Baccalauréat d’Installateur en Chauffage, Climatisation et Energies Renouvelables.
En phase avec les attentes du bassin d’emploi, la filière technologique est également présente avec un Baccalauréat Technologique STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable).
Quelques soient les filières choisies, la motivation des élèves se précise au contact des modèles professionnels dans leur entourage. Difficile en classe de troisième de se projeter dans un avenir professionnel audelà de ces références. C’est peut-être ce qui explique que des places peuvent rester vacantes en filière professionnelle, preuve de la compréhensible hésitation de jeunes de 15 ans quant à leur avenir professionnel.
Le contact avec la pratique lors des 7 semaines annuelles de stage en CAP et des 22 semaines en 3 ans pour le Baccalauréat Professionnel peut aussi faire prendre conscience d’une erreur d’orientation que les enseignants accompagnent au mieux afin d’éviter le décrochage, échec tant redouté par les 102 professionnels encadrant dont 54 professeurs. Leurs efforts conjugués ont permis d’éviter tout décrochage au cours
de l’année scolaire écoulée.
L’année scolaire 2022-2023 a apporté son lot de grandes satisfactions :
• Trois médailles, d’or, d’argent et de bronze, ont récompensé 3 élèves de terminale CAP Electricien présentés par le lycée au concours du «Meilleur Ouvrier de France», niveau départemental.
• Deux élèves ont également candidaté pour une distinction au niveau régional que leur niveau autorisait à briguer.
• Tous les élèves présentés par le lycée aux deux CAP
ont été reçus.
• La filière de l’enseignement général n’est pas en reste, avec une belle réussite aux Epreuves Anticipées de Français (habituellement surnommé « Bac Français ») pour les lycéens de 1ère puisque la moyenne générale des élèves atteint un honorable 13,5 à l’écrit comme à l’oral (supérieures pour les deux épreuves aux résultats départementaux et académiques). A la rentrée 2023, le lycée initie une option innovante en Arts Plastiques de 3 heures par semaine proposée aux élèves de 1ère de cette filière.
L’ambition du lycée est d’être à l’écoute des attentes des entreprises locales afin de faciliter au mieux l’entrée dans la vie professionnelle de ses élèves par la maîtrise des gestes professionnels. Lors des portes ouvertes très suivies, organisées en janvier 2023, les parents des futurs élèves et les entreprises ont pu apprécier la modernité des machines-outils et des postes de travail mis à dispositions des élèves par le lycée. La qualité des relations du lycée avec les entreprises, structures d’accueil des stagiaires, et plus largement avec le tissu économique local et le réseau des fournisseurs, est exemplaire.
L’ensemble de ces contacts permet actuellement au lycée de multiplier par deux son offre de stages.
C’est dans cet environnement favorable que le lycée s’est vu solliciter par l’entreprise DELTA Voile pour
organiser une formation complémentaire pour adultes d’une durée de 3 mois en assemblage de laizes de voile pour 8 salariés. Avec l’appui du GRETA, le lycée a pu dans les temps, créer de toute pièce un atelier réunissant machines et compétences.
Chargé de leur formation, le lycée public polyvalent Adeline BOUTAIN se mobilise, au quotidien, afin de permettre à ses élèves, toutes filières confondues, d’atteindre leurs objectifs de préparation à leur future vie active.
Gérard Roches.
Sources : Entretien avec Emmanuel Pierre, proviseur du lycée public
polyvalent Adeline BOUTAIN.