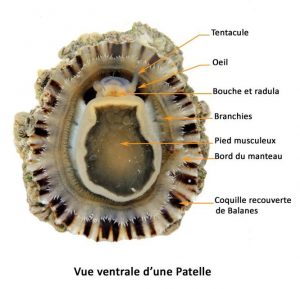Beaucoup de Gillocrutiens, de souche au moins, ont connu Gilbert HERAUD à un titre ou a un autre ; ce dernier est né le 26/12/1926 à Croix de Vie rue du Maroc, quartier qu’il n’a jamais quitté par la suite et qu’il chérissait ; il a été élevé par son grand père maternel, et a eu deux sœurs Micheline et Rosette ; par la suite il a vécu avec sa mère dans une maison qui donnait bd de l’Egalité ; Son père, René, dit « l’étudiant » était aussi marin et ses parents ont divorcé en 1936 ce qui était très rare à l’époque.
J’ai fait sa connaissance un soir à un retour de pêche en juillet 1962 (j’avais 18 ans) et lui ai fait part de ma grande envie de passer une journée sur le Thalassa ; après m’avoir posé quelques questions sur ma famille et mes études à Nantes, il m’a donné son accord ; « rendez-vous à 3 H 45 au port » ! J’étais comblé : un vieux rêve allait se réaliser.
Cette journée de juillet a été inoubliable ; la mer était belle et j’ai pu assister au lever du soleil : pure merveille de la Création ; J’ai observé longuement Gilbert, avec son béret basque, à la barre ; il semblait dans un autre monde bien que tout attentif à ce qui se passait ; il n’avait pas besoin de donner des ordres à son équipage ; chaque matelot savait parfaitement ce qu’il avait à faire avant et après le jeter des filets ; il s’adressait parfois à Jacques Pouvreau pour lui donner quelques consignes ; Jacques était propriétaire à part égale du Thalassa et avait le statut de mécanicien ; les prises étaient bonnes..
Entre deux parties de pêche j’ai du m’exécuter (en tant que touriste) au jeu de l’entonnoir qui consistait à mettre celui-ci dans mon pantalon à l’avant ; puis de mettre une pièce de monnaie sur mon front relevé afin de la faire tomber dans l’entonnoir ; A ce moment là un matelot se faufilait derrière moi pour vider le contenu d’une bouteille d’eau dans l’entonnoir ; ce qui provoquait un éclat de rire général dans l’équipage patron y compris ; l’ambiance était très gaie sur le Thalassa : c’est vrai qu’il n’y avait pas de stress à une époque ou la réglementation européenne était souple.
Au retour à terre il était de coutume de prendre un verre au Café du PMU dit « le Bouillon » pour la tournée du patron et la paye qui se faisait en liquide ; Le silence était la règle tant la fatigue se faisait sentir sur les visages après 12 à 13 H en mer.
Revenons à Gilbert ; au cours de sa carrière il a navigué successivement dés l’age de 14 ans sur la Petite Simone comme mousse puis sur la Monique enfin sur l’Ondine toujours comme marin ; ensuite il est devenu patron pêcheur à bord du Thalassa, un navire de 24 tonneaux, à partir de 1958 jusqu’en 1981. Il a vécu en harmonie totale avec son équipage qui appréciait sa bonne humeur et son flair pour détecter les bancs de poissons ; le Thalassa pratiquait la pêche à la sardine au filet tournant de mai à septembre et le chalut plus les coquilles saint Jacques l’hiver. Les prises du bateau étaient limitées aux besoins du mareyage et des usines de conserve : les quantités étaient affichées à « la baraque » (local du syndicat des marins) et variaient selon le nombre de matelots à bord ; Le Thalassa, qui a été le dernier bolincheur du port, a été acquis bien plus tard par une association des Sables « l’Océane » qui l’a laissé à l’abandon.
Gilbert prenait activement part à la vie du port que ce soit au comité local des pêches, au comité de la sardine…..il a été aussi le représentant, un temps, des marins C.G.T. (clin d’œil à la classe ouvrière). Les revendications du syndicat portaient sur la juste rémunération des marins ; puissante à la sortie de la guerre, elle a perdu de son influence par la suite cela était certainement lié au charisme et à la fougue de Louis VRIGNAUD : il était secrétaire du syndicat professionnel des Marins et a consacré sa vie à la défense du monde maritime.
A l’actif de la CGT la création de la coopérative de mareyage l’Avenir en 1946, puis en 1948 d’une usine de conserve crée conjointement par les marins CGT et la SGCC (Société Générale des conserves coopératives) appelée Bilbao sur la route des Sables en souvenir des réfugiés espagnols qui avaient fui le régime franquiste en 1936. Le climat était bon entre les deux syndicats à tel point qu’ils ont été à l’origine de la création de Vendée Océan en remplacement de l’Avenir qui rencontrait de sérieuses difficultés ; Chaque partie était représentée par 6 professionnels et la constitution officielle de Vendée Océan s’est faite le 14 août 1959. ; Dans les négociations la CGT était représentée par Yvon Praud et Raymond Nadeau.
Bien que « de bord différent » Gilbert avait un lien fort avec « le grand Louis » (1) qui présente Gilbert comme « un bon marin agissant avec beaucoup de bon sens , soucieux de l’intérêt général » « il parlait peu mais quand il ouvrait la bouche on ne savait pas s’il était sérieux ou blagueur » . Témoin de la solidarité entre gens de mer le dépannage de Louis Vrignaud, dans des conditions rocambolesques liées au évènements de mai 1968 a permis la réparation du moteur du Thalassa qui avait lâché ; Louis l’avait emmené à Surgères à l’usine Poyaud pour chercher les pièces nécessaires à la réparation de son moteur de 172 CV.
Gilbert est entré à la SNSM en 1969 et il a été successivement patron suppléant de Paul Fortineau puis patron tout court de la vedette « patron aimé Baud » et cela de 1974 à sa maladie ; il a été le témoin direct d’un drame de la mer, qui a eu lieu le 28/5/1985, concernant le navire l’Alnilam : Michel Abillard, patron du navire, a péri en mer dans le secteur de l’Ile d’Yeu lors d’un virement de bord dans des conditions tragiques.
 Pour tout son dévouement à la cause des marins Gilbert a été décoré au grade d’officier du Mérite maritime par Louis Vrignaud le 9 novembre 1985.
Pour tout son dévouement à la cause des marins Gilbert a été décoré au grade d’officier du Mérite maritime par Louis Vrignaud le 9 novembre 1985.
Gilbert a été élu municipal de Croix de Vie du 21 mars 1965 au 1er janvier 1967, date de la fusion, avec comme maire Marcel Ragon ; il a œuvré surtout dans le cadre de la commission maritime ; les archives municipales sont muettes sur les interventions de Gilbert tant il est vrai qu’à cette époque c’est le Maire qui présentait tous les sujets à l’ordre du jour et le conseil votait pratiquement toujours à l’unanimité les projets présentés.
Gilbert a toujours chéri son quartier du Maroc ; une preuve parmi tant d’autres : il a été à l’initiative, suite à un article dans Vendée matin du 17/7/1986, d’une pétition « signée par les touaregs et autres souks du Maroc (sic) » qui évoquait « un projet de construction d’immeubles décents et neufs » dans un quartier où « il est bon de respirer les effluves des sardines et non l’odeur du pétrole ou du gaz oïl et qui autorisait la circulation des véhicules dans un quartier apprécié par les estivants pour son calme » ; par un communiqué en date du 27/8/1986 le Maire Jean Rousseau rassura : les projets d’évolution de ce quartier « qui avaient en leur temps suscité l’émotion des propriétaires ont été abandonnés en 1977 et le Plan d’Occupation des sols « assurait la conservation de ce secteur et comportait un règlement propre à lui garantir son caractère spécifique ».
Il est impossible de ne pas évoquer en conclusion l’homme tout court, l’ami BEBERT qui côtoyait beaucoup de monde, de tous les milieux, comme l’humoriste Pierre Desproges ; les compères aimaient se retrouver au café « chez Bougnat » rue du Maroc ou il faisait bon faire une partie de boules entre deux verres de rouge.
Autant Bébert était discret en mer autant il devenait un bon vivant à terre ; j’ai le souvenir d’une soirée à la crêperie du Récif à Sion ou on buvait et buvait encore en frères à la « santé des amoureux, à la santé du roi de France … » en chantant tard dans la nuit ; d’autres ont en mémoire les banquets de marins (SNSM…) ou Bébert aimait entonner « La pompe à Merde », une chanson de carabin.
Bébert était viscéralement attaché à sa terre de Croix de Vie ce qui ne l’empêchait pas d’avoir des idées de progrès ; ce quartier du Maroc ou autrefois à l’heure du repas les hommes ramenaient la part du pêcheur et ou tout le monde se retrouvait au café du coin pour manger des grillades avec des pommes de terre. C’était la fête !
Nombreux sont ceux qui l’ont accompagné jusqu’au bout (Bebert est décédé le 9/11/1991 sur ses 65 ans d’un cancer du poumon); comme le chantait Brassens, dans « les copains d’abord », les nombreux présents à son enterrement civil « c’étaient pas des anges, l’Evangile ils l’avaient pas lu mais ils s’aimaient tout’s voil’s dehors, les copains d’abord… » ; L’oraison funèbre prononcée par Sylvain Rebeyrotte fut à la hauteur : plein d’éloge et plein de tendresse vis-à-vis de l’homme de cœur et de raison qu’était Bébert ; Là ou tu reposes désormais Bébert j’émets le vœu que nous soyons quelques uns à fleurir ta tombe à la Toussaint prochaine.
Jean Michel BARREAU
jm.barreau9444@orange.fr
- A lire « J’ai posé mon sac à terre » de louis VRIGNAUD
(Appel pour mes recherches futures: si vous avez la collection des revues « La Hutte Radio Pil’Hours» parues dans les années 60 merci de me le faire savoir)